Qu’est-ce qu’une levée de fonds et comment réussir son opération de financement ?
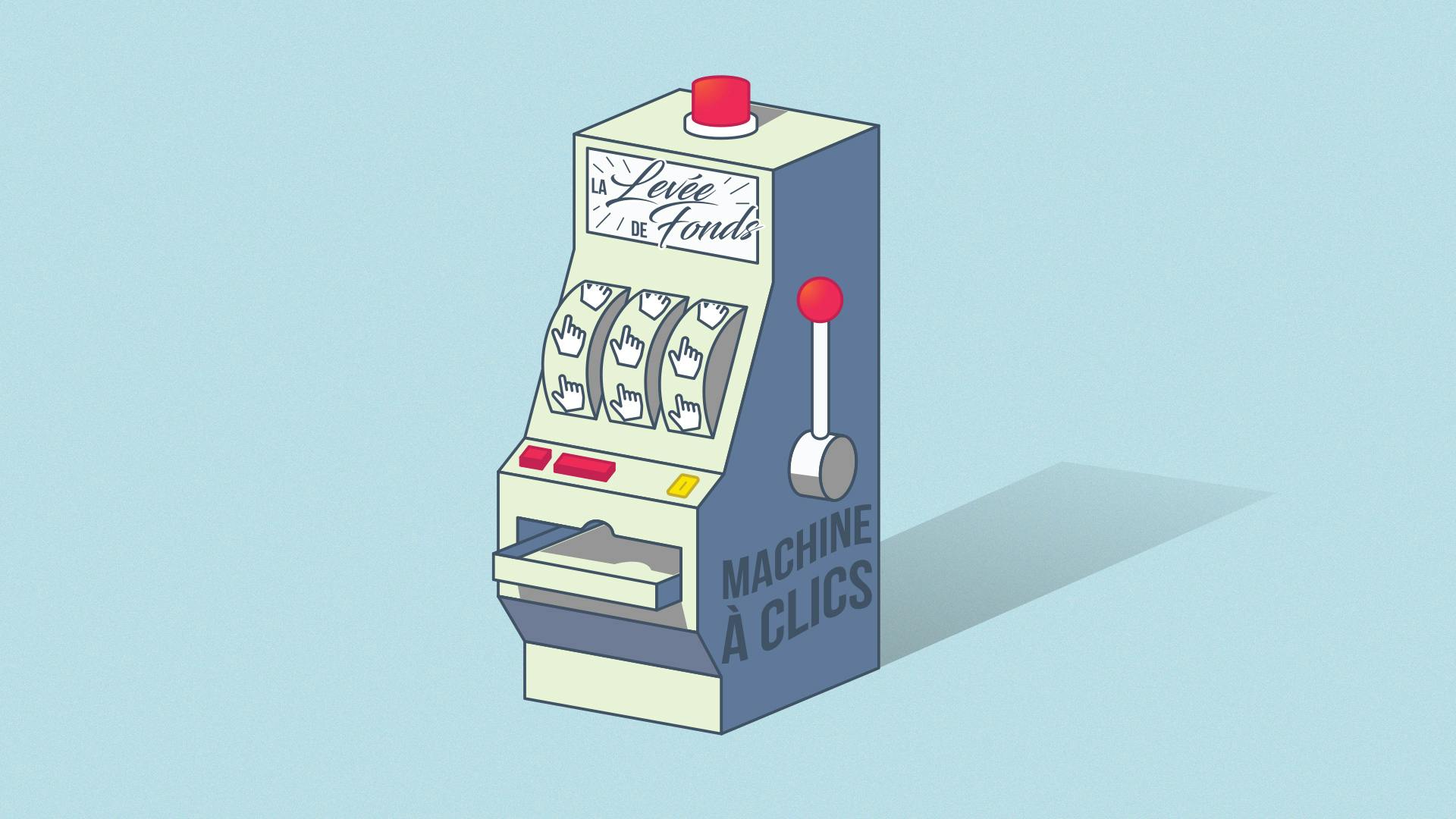
La création et/ou le développement d’une startup ou d’une PME nécessitent de pouvoir compter sur des sommes d’argent importantes.
La question est de savoir : où les trouver ? C’est là qu’intervient la levée de fonds : un levier de financement alternatif à l’emprunt qui permet au porteur de projet de donner vie à son idée (en phase d’amorçage) ou d’orienter sa structure dans la bonne direction (en phase de croissance).
En pratique, il s’agit de faire entrer des investisseurs extérieurs dans le capital de la société : des personnes physiques ou morales reçoivent des titres en contrepartie des fonds qu’ils apportent.
Un processus qui, pour certains types d’entreprises – notamment les startups – s’avère tout à fait incontournable.
Alors, qu’est-ce qu’une levée de fonds précisément ? Que faut-il savoir sur ce mode de financement bien particulier ? Et comment se préparer à lever efficacement des fonds ?
Qu’est-ce qu’une levée de fonds ?
Commençons avec une définition claire de la levée de fonds.
Même si vous avez l’habitude de voir passer cette expression dans les médias, c’est un mécanisme financier complexe dont il est préférable de bien comprendre les tenants et les aboutissants.
Une levée de fonds, comme son nom l’indique, est un levier de financement : on cherche littéralement à obtenir de l’argent pour concrétiser une idée de business ou pour faire croître une entreprise existante.
C’est le cas, du moins, du point de vue de l’entrepreneur ou du porteur de projet.
L’originalité vient de la méthode appliquée : l’entreprise recherche des investisseurs (business angels, fonds d’investissement ou institutions) susceptibles d’investir dans son capital.
Les conditions de sortie sont, d’ailleurs, souvent fixées à l’avance, dès le stade de la prise de participation.
En contrepartie des apports financiers, ces investisseurs perçoivent des parts de la société et, à plus long terme, des bénéfices sur les résultats.
Pourquoi réaliser une levée de fonds ?
Dans les faits, la levée de fonds est une opération permettant à l’entreprise d’augmenter son capital social au gré des apports réalisés par les investisseurs.
Avec ces liquidités, la société est en mesure de réaliser un projet ou, plus globalement, de financer sa croissance (par exemple, en recrutant du personnel et en investissant dans du matériel de production).
Ce type d’opération peut d’ailleurs concerner n’importe quel type de projet entrepreneurial.
Ce faisant, la levée de fonds constitue une alternative aux leviers classiques de financement, en particulier l’emprunt bancaire souvent réservé à des sociétés déjà bien installées ou à des personnes capables d’offrir des garanties solides.
L’entreprise a l’avantage de ne pas contracter de dette et de ne pas mettre en jeu les garanties personnelles de ses dirigeants ou associés, car les fonds injectés ne doivent pas être restitués aux investisseurs.
Il existe encore un autre avantage. En levant des fonds, l’entreprise bénéficie des réseaux des investisseurs, ce qui ouvre la porte à de nouvelles compétences et à des opportunités de marché.
Dans certains cas, notamment en phase d’amorçage, elle peut également compter sur l’expérience et les connaissances de business angels qui sont aussi des entrepreneurs chevronnés, ou bien sur les outils mis à disposition par les institutions comme Bpifrance ou les fonds d’investissement.
Du côté des investisseurs, l’intérêt est double :
- La prise de participation s’accompagne, sur le long terme, d’un gain financier. Concrètement, les porteurs de parts perçoivent des dividendes lorsque l’entreprise réalise des bénéfices.
- Les investisseurs peuvent aussi générer une forte plus-value lors de la revente des titres, pour peu que la société ait été valorisée au fil du temps. En ce sens, c’est donc une forme de placement financier.
Quels sont les effets d’une levée de fonds ?
Compte tenu des spécificités de ce levier de financement, la levée de fonds entraîne plusieurs effets qu’il est important de bien avoir en tête.
En premier lieu, l’entreprise augmente significativement ses fonds propres avec l’argent injecté par les investisseurs, ce qui lui permet de renforcer sa capacité de financement. Il s’agit, bien entendu, du but principal de l’opération.
En second lieu, du fait même de ce mécanisme d’apport, la société est dans l’obligation de faire entrer les investisseurs au capital.
Avec une conséquence notable : en contrepartie des fonds apportés, la structure doit émettre de nouveaux titres sociaux afin de les distribuer aux nouveaux entrants… ce qui conduit à une dilution du pouvoir des fondateurs.
C’est une incidence à ne surtout pas prendre à la légère, parce qu’elle implique une répartition différente des pouvoirs au sein de la structure.
En pratique, le poids des associés fondateurs dans la prise de décision est amoindri, puisqu’un plus grand nombre de personnes participe au capital.
Il faut garder en tête, en effet, que les titres sociaux s’accompagnent de droits de vote : plus un investisseur détient de titres, et plus son influence sur l’entreprise peut s’avérer significative.
De cette dilution due à la levée de fonds peuvent surgir des tensions, les objectifs des uns et des autres étant parfois très différents.
Imaginez, par exemple, que les investisseurs souhaitent orienter les décisions afin de renforcer la rentabilité de l’entreprise… alors que les membres fondateurs ont une vision moins lucrative de leur activité. Il s’en suivra forcément un conflit, aux dépens de la pérennité de la société.
Pour éviter d’en arriver là, il est toutefois possible de limiter les droits octroyés aux investisseurs en établissant un pacte d’actionnaires (nous y reviendrons plus bas).
Autre conséquence à avoir à l’esprit : en cas de dilution, les associés fondateurs disposent certes de moins de droits de vote en assemblée, mais ils y perdent aussi sur le plan financier.
Ils percevront moins de dividendes et moins de quote-part de plus-value dans l’éventualité d’une cession de la société.
Bon à savoir
La levée de fonds doit être envisagée seulement lorsqu’elle est nécessaire à la création ou au développement de l’entreprise, et à l’atteinte de ses objectifs.
En d’autres termes, cette opération doit répondre à un réel impératif de financement et au besoin d’obtenir de nouveaux moyens humains et professionnels.
Qui peut lever des fonds ?
En théorie, toutes les sociétés sont en droit de lever des fonds.
Nous avons bien écrit « sociétés » plutôt que « entreprises », et pour une bonne raison : seules les formes juridiques comprenant plusieurs associés peuvent lancer des opérations de levée de fonds, car cela suppose d’avoir la possibilité d’émettre des titres sociaux et de les attribuer aux investisseurs.
Ce qui est impossible aux entrepreneurs individuels et aux structures unipersonnelles.
En règle générale, les sociétés qui prévoient de collecter des fonds de cette manière optent pour la forme de la SAS (société par actions simplifiées) ou pour celle de la SA (société anonyme).
La SARL (société à responsabilité limitée) est plus rare, tout simplement parce que le nombre d’associés est limité à 100.
Dans les faits, ce sont surtout les startups qui ont recours au mécanisme de la levée de fonds.
Pour le comprendre, il faut savoir que le modèle économique des startups diffère grandement de celui d’un projet entrepreneurial plus classique, dans le sens où il est établi au fil du temps plutôt que fixé en amont de la création de l’activité.
En pratique, l’entreprise passe par une phase d’expérimentation avant de générer des revenus et de devenir rentable.
Dans ce cadre bien particulier, les levées de fonds servent en premier lieu à couvrir les investissements nécessaires au démarrage de l’activité (achat de matériel et recrutement, R&D) et à garantir les besoins de l’entreprise durant les premières années de son existence, jusqu’à ce qu’elle atteigne le seuil de rentabilité.
L’investissement extérieur est donc le seul moyen (ou presque), pour une startup, de disposer de liquidités pour se développer.
Par ailleurs, les startups se caractérisent par un fort potentiel de croissance, ce qui attire l’attention des investisseurs.
Car ceux-ci ont tout intérêt à ce que l’entreprise dans laquelle ils ont injecté des fonds puisse se développer rapidement, afin qu’ils en tirent un bénéfice tangible – notamment lors de la revente de leurs titres.
Quelles sont les différentes formes de levées de fonds ?
Allons plus loin dans l’exploration des mécaniques de la levée de fonds, en précisant qu’il en existe plusieurs types en fonction de l’avancement de l’entreprise à l’origine de l’opération.
On distingue ainsi la levée de fonds pour amorcer un projet (capital amorçage) et la levée de fonds pour le développer (capital développement).
Le capital amorçage
Comme son nom le laisse aisément entendre, le capital amorçage permet de lever des fonds dans le but de démarrer une activité ou de lancer un produit/service.
Les montants concernés sont généralement faibles, car l’entreprise est peu valorisée : les investisseurs (des business angels pour l’essentiel) se fient donc exclusivement à son potentiel d’avenir. On parle aussi de « levée de fonds en pré-seed ».
Le capital développement
Au stade du capital développement, l’entreprise cherche à lever des fonds pour booster sa croissance et poursuivre sa progression.
Les montants levés sont plus importants qu’en phase d’amorçage, car la valorisation est déjà acquise, et souvent injectés par des fonds d’investissement.
Cet argent sert, le plus souvent, à recruter des collaborateurs, à améliorer les produits ou services, et à optimiser la communication et le marketing afin de trouver des clients. On parle aussi de « seed » ou de « premier tour de table ».
Au-delà du « seed », le capital développement se décline en trois typologies, selon le stade de croissance de l’entreprise :
- La levée de fonds en série A intervient à un stade avancé de la croissance, alors que l’entreprise génère du chiffre d’affaires, et sert à accélérer le développement externe ou interne. Les montants impliqués se chiffrent en millions d’euros.
- La levée de fonds en série B est destinée aux entreprises bien établies, qui connaissent une croissance économique continue et ambitionnent de se développer au-delà des frontières françaises. Les fonds atteignent plusieurs dizaines de millions d’euros.
- La levée de fonds en série C vise à poursuivre la croissance de l’entreprise, à gagner des parts de marché, à recruter du personnel et à racheter des concurrents, pour des montants supérieurs à 100 millions d’euros.
Comment lever des fonds ? Les étapes à suivre pour préparer une levée de fonds et convaincre des investisseurs
Maintenant que nous avons largement expliqué le fonctionnement d’une levée de fonds, il est temps de passer à la question pratique : comment une entreprise peut-elle convaincre les investisseurs de la soutenir financièrement ? Pour répondre à cette interrogation, nous vous proposons de suivre les grandes étapes de la réalisation d’une levée de fonds.
1. Estimer le montant à lever
C’est la première étape de toute levée de fonds : il vous faut estimer précisément les besoins financiers de l’entreprise en corrélation avec son potentiel de croissance.
Pour le dire autrement, il s’agit de donner des objectifs concrets à l’opération, dans l’idée de lever suffisamment de fonds pour assurer le développement rapide de l’activité… tout en veillant à ce que les associés fondateurs conservent le contrôle (ce qui en revient à se montrer raisonnable quant aux sommes demandées).
Ici, une grande précision dans le chiffrage est de mise, ce qui n’est possible qu’en s’appuyant sur des projections pertinentes en matière de trésorerie – notamment grâce au business plan – pour les deux prochaines années.
Vous devez budgétiser avec soin l’ensemble des dépenses nécessaires au développement de votre structure : recrutement, R&D, ouverture de points de vente, développement de nouveaux produits ou services, acquisition des clients, etc.
En tenant compte de la durée moyenne d’une levée de fonds (entre 6 et 9 mois), il est préférable de prévoir un financement suffisant pour couvrir une période de 2 ans.
Cela vous permettra de fonctionner normalement, sans devoir consacrer à nouveau du temps à la recherche de fonds.
2. Valoriser le projet
Cette étape s’applique aux levées de fonds en phase d’amorçage, c’est-à-dire dans le cadre d’une création de projet.
Il s’agit de valoriser l’entreprise ou la startup afin de convaincre les investisseurs de vous accompagner dans votre ambition entrepreneuriale.
Sans rien d’autre, à portée de main, que votre business plan et des idées plus ou moins concrètes, mais qui n’ont pas encore été testées en situation réelle.
La tâche est complexe, dans la mesure où les méthodes traditionnelles de valorisation sont réservées aux entreprises classiques : on s’appuie généralement sur le montant du chiffre d’affaires, sur les derniers bilans ou sur une comparaison de la rentabilité avec d’autres structures équivalentes. Ce dont vous ne disposez pas encore pour votre entreprise.
Puisque la société n’existe pas encore, la valorisation dépend de multiples facteurs comme le stade d’avancement du projet, la nature du produit ou du service développé, le degré d’innovation, le positionnement de marché, la taille et la nature du marché ciblé, ou encore les perspectives de bénéfices.
3. Identifier des investisseurs ou des fonds
À ce stade, vous devez identifier des business angels ou des fonds d’investissement susceptibles de participer à votre levée de fonds.
Notez que la recherche de l’investisseur idéal ne se limite pas à une question d’argent : au-delà du financement, il y a aussi les compétences (expertise métier, savoir-faire) et le réseau que votre interlocuteur peut mettre à votre disposition.
En vue d’une levée de fonds, les investisseurs sont généralement classés :
- En fonction du stade de développement de l’entreprise et du montant à lever.
- Par secteur d’activité.
- Par objectif d’investissement (réaliser une plus-value et/ou apporter une contribution supplémentaire au projet).
Une fois dressé le profil de l’investisseur idéal, il vous faut prendre contact, soit directement (via LinkedIn, par exemple), soit en suivant la procédure indiquée sur le site web de la personne ou du fonds.
4. Pitcher le projet
Là encore, cette étape concerne les projets en phase de création.
Lorsqu’un investisseur est intéressé, les associés sont invités à pitcher leur projet, c’est-à-dire à en faire une présentation rapide. On parle aussi de pitch deck.
Pour mettre un maximum de chances de votre côté, vous devez connaître votre pitch sur le bout des doigts, respecter le temps imparti (une, trois ou dix minutes) et soigner la présentation de votre executive summary.
L’idée étant de convaincre votre interlocuteur en un minimum de temps, pour un maximum d’effet.
À l’issue du pitch, une session de questions-réponses permet d’approfondir le projet et de détailler sa faisabilité.
Par la suite, d’autres rendez-vous peuvent être programmés pour consolider les échanges.
5. Apporter les éléments nécessaires à la prise de décision
Une fois la présentation terminée, et durant les semaines qui suivent, les investisseurs passent le dossier au crible en lui appliquant un certain nombre de filtres. Ceux-ci ont trait :
- au potentiel du marché,
- à la viabilité des projections financières,
- au « time-to-market »,
- aux compétences et à la complémentarité des associés,
- à la faisabilité technique,
- ainsi qu’à la rentabilité potentielle du projet (et donc au retour sur investissement qu’ils peuvent espérer).
Cette étape doit être préparée avec une grande rigueur, car les décisions des investisseurs sont très souvent prises en tenant compte de points bien spécifiques. Deux conseils :
- D’une part, il faut vous montrer réactif et apporter, dans les meilleurs délais, les éléments d’information complémentaire qui vous sont demandés.
- D’autre part, une analyse juridique approfondie doit être anticipée. De nombreux dossiers échouent à ce stade en raison d’un manquement ou d’un flou juridique, par exemple à cause de contrats mal ficelés ou d’une disposition législative mal appliquée. Notre conseil est donc de réaliser un audit juridique en amont.
Si vous parvenez à franchir ces écueils, l’investisseur peut vous confirmer son intérêt par le biais d’une lettre d’intention.
Celle-ci reprend les éléments clés de l’opération, dont le montant de l’investissement, le nombre de titres émis en contrepartie, la réorganisation de l’entreprise à l’issue de la levée de fonds, et le calendrier des étapes suivantes.
La lettre comprend également des conditions, ou clauses, qui permettront à l’investisseur de se désengager si elles ne sont pas satisfaites.
C’est le point de départ de la procédure de due diligence, la dernière étape avant la négociation.
6. Gérer les négociations et faire le closing
En phase de négociation, les deux parties se mettent d’accord sur les détails de la levée de fonds. Cet accord implique de faire des concessions afin que tout le monde y trouve son compte.
D’une part, l’investisseur désire sécuriser les fonds injectés, son objectif étant de réaliser une plus-value lors de la revente des titres (et, plus globalement, de bien investir son argent).
D’autre part, les fondateurs veulent éviter qu’une dilution trop importante ne vienne remettre en cause leur pouvoir de décision.
Une fois l’accord trouvé, la transcription juridique des négociations peut prendre deux formes :
- L’adaptation des statuts de l’entreprise et la publication d’un avis de modification dans un journal d’annonces légales. Au passage, le dirigeant doit déposer une demande de modification via le portail INPI, ce qui donne lieu à l’émission d’un nouvel extrait Kbis mentionnant (entre autres) le capital social modifié.
- L’établissement d’un pacte d’actionnaires, qui est la version « mature » de la lettre d’intention. Ce document détaille les règles applicables aux relations entre les associés, sans devoir passer par une modification des statuts. Il peut, par exemple, prévoir une répartition spécifique du pouvoir de prise de décision, en laissant plus de contrôle aux membres fondateurs.
La signature des documents constitue le closing. Les fonds sont ensuite versés sur le compte bancaire de l’entreprise… et une nouvelle étape de la vie de celle-ci démarre !
Bon à savoir
Dans une société, toute augmentation du capital social doit faire l’objet d’un vote des actionnaires ou des associés lors d’une assemblée générale.
À cette occasion, les membres s’expriment sur le changement du montant du capital, sur le nombre de titres à émettre, et sur les droits qui leur sont attachés.
Vous savez désormais comment fonctionne une levée de fonds et, plus important, comment vous préparer à rencontrer des investisseurs pour collecter l’argent nécessaire à l’amorçage ou au développement de votre projet entrepreneurial.
Pour en savoir plus à ce sujet, il est recommandé de suivre une formation en création d’entreprise.
Gardez en tête que la levée de fonds est un puissant levier de financement, parfois indispensable pour certaines entreprises, mais que ses conséquences ne doivent surtout pas être négligées.
En l’occurrence, il s’agit du risque de dilution du pouvoir de décision des associés fondateurs.
Suivre le podcast
S’abonner au podcast
Recevez mes derniers podcasts directement dans votre boîte mail.














